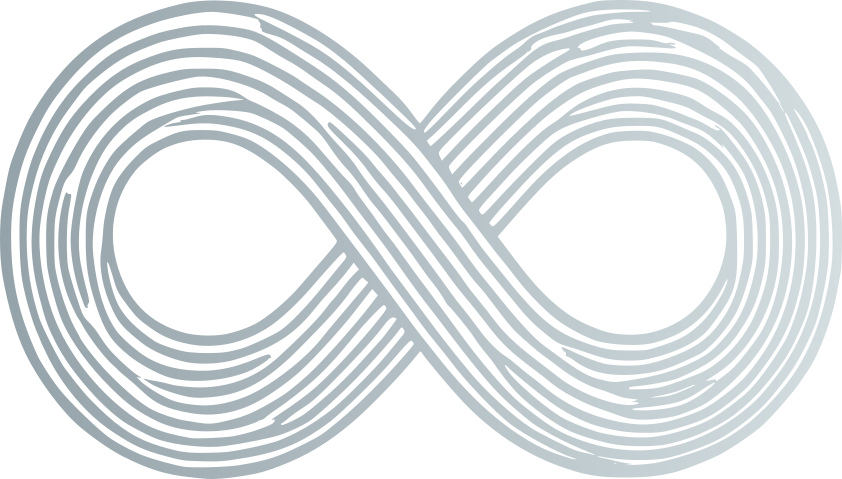En bref
Une étude longitudinale menée sur plusieurs décennies auprès de près de 3000 adultes âgés a mis en lumière un lien entre le décalage de l’heure des repas avec l’âge, en particulier le petit-déjeuner tardif, et des problèmes de santé physique et psychologique accrus, ainsi qu’un risque de mortalité plus élevé. Le moment du petit-déjeuner pourrait servir de marqueur simple et facile à surveiller de l’état de santé général chez les personnes âgées.
Introduction
Le moment où nous mangeons, et non pas seulement ce que nous mangeons, est un domaine de recherche croissant connu sous le nom de chrononutrition. Avec l’âge, les habitudes alimentaires et les rythmes circadiens peuvent se modifier, ce qui soulève la question de l’impact de ces changements sur la santé à long terme. Cette vaste étude s’est attachée à déterminer comment les trajectoires des horaires de repas évoluent au cours du vieillissement et dans quelle mesure elles sont associées à la morbidité et à la longévité. Les résultats fournissent des informations concrètes sur l’importance du rythme des repas pour maintenir une bonne santé en vieillissant.
Protocole de l’étude : suivi des habitudes alimentaires sur plusieurs décennies
Cette recherche est basée sur l’analyse des données de la Longitudinal Study of Cognition in Normal Healthy Old Agemenée par l’université de Manchester au Royaume-Uni.
- Type et durée de l’étude : Il s’agit d’une étude de cohorte longitudinale avec un suivi étalé sur plus de 20 ans (entre 1983 et 2017).
- Participants : L’échantillon comprenait 2945 adultes âgés vivant dans la communauté.
- Collecte de données : Les participants ont auto-déclaré l’heure de leurs repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) à plusieurs reprises au cours du suivi. Ils ont également répondu à des enquêtes sur leur état de santé (maladies physiques et psychologiques, fatigue, anxiété, multimorbidité). Des échantillons génétiques ont été analysés pour déterminer les profils génétiques liés au chronotype (préférence pour le matin ou le soir).
- Analyse statistique : Les chercheurs ont utilisé des modèles statistiques avancés (analyse de classe latente et régression de Cox) pour identifier les trajectoires de changement dans les horaires de repas avec l’âge et pour évaluer l’association de ces trajectoires avec le développement de maladies et la mortalité toutes causes confondues.
Résultat de l’étude : le décalage du petit-déjeuner est un signal de risque
L’analyse des données a permis de mettre en évidence des tendances claires dans les habitudes alimentaires des personnes âgées et leurs conséquences sur la santé.
- Changements avec l’âge : Il a été observé que les personnes âgées ont généralement tendance à prendre leur petit-déjeuner et leur dîner à des heures plus tardives, ce qui entraîne une réduction de la fenêtre alimentaire quotidienne globale.
- Association avec la morbidité : Le petit-déjeuner tardif était l’élément le plus fortement associé à la présence de problèmes de santé, qu’ils soient physiques (fatigue, problèmes de santé bucco-dentaire) ou psychologiques (dépression et anxiété), ainsi qu’à la multimorbidité (présence de plusieurs maladies chroniques).
- Lien génétique et comportemental : Les participants ayant un profil génétique de chronotype du soir (les « couche-tard ») avaient une tendance à manger leurs repas plus tard.
- Impact sur la longévité : L’analyse a identifié un groupe de « mangeurs tardifs » et un groupe de « mangeurs précoces ». Le groupe des mangeurs tardifs a affiché un taux de survie à 10 ans significativement inférieur (86.7%) par rapport au groupe des mangeurs précoces (89.5%).
Ce que nous pouvons faire pour notre santé selon cette étude
Cette étude suggère que le moment du repas n’est pas un facteur neutre pour la santé, en particulier à un âge avancé. L’action principale se concentre sur le maintien d’une routine alimentaire matinale régulière.
- Prioriser un petit-déjeuner matinal : Manger le petit-déjeuner plus tôt dans la journée est un comportement simple associé à de meilleures trajectoires de santé et de longévité. Il est conseillé de maintenir une heure de petit-déjeuner cohérente et relativement matinale même après la retraite ou en cas de changement de rythme de vie.
- Surveiller les changements d’habitudes : Un décalage vers des heures de repas plus tardives, notamment pour le petit-déjeuner, peut être un signal d’alarme précoce indiquant l’apparition ou l’aggravation de problèmes de santé sous-jacents (comme la fatigue ou la dépression). Il est pertinent de discuter de tout changement notable des habitudes alimentaires avec un professionnel de la santé.
- Aligner les repas sur le rythme circadien : Cette recherche ajoute du poids au concept de la chrononutrition, qui suggère que l’alignement de l’apport alimentaire sur les rythmes biologiques (manger lorsque le métabolisme est le plus efficace, soit plus tôt dans la journée) est bénéfique pour la santé métabolique et cardiovasculaire, des facteurs clés de la longévité.
Conclusion
L’étude démontre que la modification des horaires de repas avec l’âge, spécifiquement l’habitude de prendre le petit-déjeuner plus tard, est associée à un état de santé moins favorable et à une réduction de la longévité. Le moment où nous consommons notre premier repas pourrait donc être un indicateur simple, mais puissant, de l’état de santé général. Ces résultats orientent vers des stratégies de vieillissement sain, insistant sur le fait que la régularité et le moment précoce des repas, en particulier le matin, sont des leviers comportementaux à considérer pour optimiser la santé et prolonger l’espérance de vie en bonne santé.
Source
Dashti, H. S., Liu, C., Deng, H., Sharma, A., Payton, A., Maharani, A., & Didikoglu, A. (2025). Meal timing trajectories in older adults and their associations with morbidity, genetic profiles, and mortality. Communications Medicine, 5(1), 385. https://www.nature.com/articles/s43856-025-01035-x