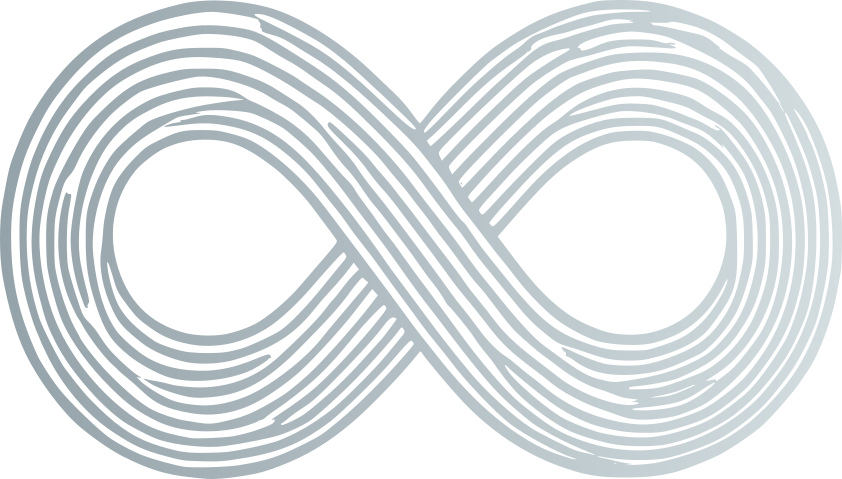En bref
Une étude publiée dans The new england journal of medicine a évalué l’efficacité de l’aspirine à faible dose (AFDC)comme traitement adjuvant pour les patients atteints de cancer colorectal localisé et porteurs d’une altération du gène PI3K. Les résultats indiquent que l’utilisation régulière de l’AFDC chez ce sous-groupe de patients post-chirurgie réduit de moitié le risque de récidive, offrant un gain significatif en termes de survie et de longévité.
Introduction
Le cancer colorectal représente une menace majeure pour la santé et la longévité. Si la chirurgie et la chimiothérapie sont des traitements établis, la recherche se tourne vers des approches personnalisées basées sur le profil génétique de la tumeur. L’aspirine, un médicament largement disponible et peu coûteux, est déjà connue pour réduire le risque initial de développer un cancer colorectal. Cependant, cette nouvelle étude a cherché à confirmer son rôle dans la prévention de la récidive, en se concentrant sur un sous-groupe précis de tumeurs : celles présentant une altération du gène PI3K. Cette approche ciblée ouvre une voie prometteuse pour améliorer l’espérance de vie des patients concernés.
Protocole de l’étude
L’étude, de grande envergure, visait à évaluer les bénéfices et les risques de l’aspirine à faible dose dans le traitement adjuvant (post-chirurgie) du cancer colorectal localisé.
- Population ciblée : L’étude s’est concentrée sur des patients ayant subi une chirurgie pour un cancer du côlon ou du rectum localisé. Le critère d’inclusion essentiel était la présence d’une altération génétique du PI3K au sein de la tumeur. Le gène PI3K régule des processus cellulaires clés comme la croissance et la division ; sa mutation peut entraîner une prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses.
- Intervention : Les chercheurs ont comparé l’effet d’une dose quotidienne d’aspirine faible (dosage souvent utilisé pour la prévention cardiovasculaire) par rapport à l’absence de traitement ou à un placebo chez ces patients.
- Mesure principale : L’issue principale mesurée était le taux de récidive du cancer après l’opération. L’étude a également pris en compte les risques associés à l’aspirine, notamment les saignements gastro-intestinaux et les hémorragies intracrâniennes.
Résultats de l’étude
Les résultats démontrent un effet protecteur majeur et ciblé de l’aspirine chez le sous-groupe génétique étudié.
L’utilisation d’aspirine à faible dose chez les patients avec un cancer colorectal localisé et porteurs de l’altération PI3K a conduit à une réduction du risque de récidive de l’ordre de 50% après la chirurgie. En d’autres termes, ce traitement ciblé a divisé par deux la probabilité que la maladie réapparaisse. Cet effet significatif n’a pas été observé avec la même ampleur chez les patients dont les tumeurs ne présentaient pas cette altération génétique spécifique, soulignant l’importance de la médecine de précision. L’étude confirme que l’aspirine agit de manière particulièrement efficace dans les voies de signalisation dérégulées par la mutation PI3K. Cependant, les chercheurs ont également réitéré la nécessité de considérer les risques de l’AFDC, notamment l’augmentation du risque de saignements majeurs.
Conclusion
Cette recherche marque une avancée significative dans la compréhension du rôle de l’aspirine dans le traitement du cancer. En identifiant l’altération génétique PI3K comme un biomarqueur prédictif de la réponse à l’aspirine, l’étude valide l’efficacité d’une approche thérapeutique ciblée. Pour les patients porteurs de cette mutation, l’aspirine à faible dose se positionne comme un outil puissant pour réduire drastiquement le risque de récidive, contribuant directement à une meilleure longévité. Cette stratégie doit cependant être mise en œuvre sous stricte surveillance médicale pour équilibrer les bénéfices oncologiques et les risques hémorragiques.
Source
Martling, A., Hed Myrberg, I., Nilbert, M., et al. (2025). Low-dose aspirin for PI3K-altered localized colorectal cancer. The New England Journal of Medicine, 393(11), 1051-1064. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2504650