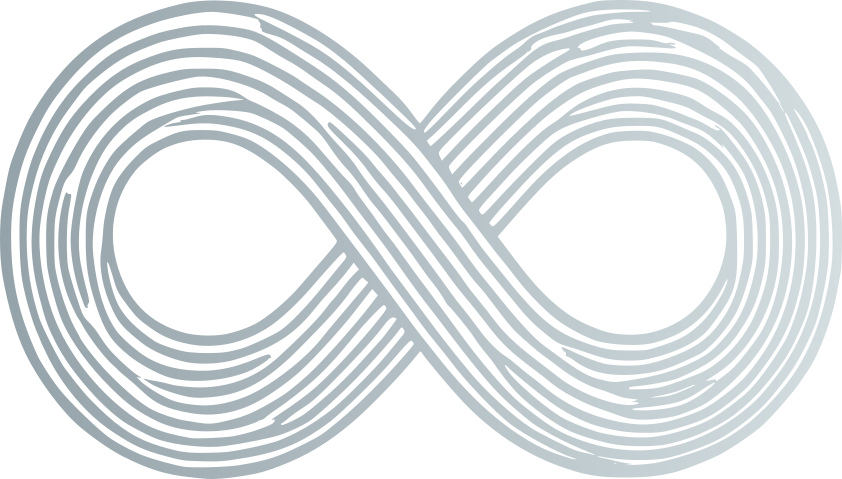En bref
Une étude a examiné l’impact d’une exposition de courte durée aux microplastiques et nanoplastiques chez des souris porteuses du gène humain APOE4, un facteur de risque majeur de la maladie d’Alzheimer. Les résultats indiquent que ces particules de plastique s’accumulent dans le cerveau et interagissent avec le gène APOE4 pour promouvoir des déficits cognitifs et altérer les voies immunitaires et métaboliques, signalant un risque accru de neurodégénérescence.
Introduction
Les microplastiques et nanoplastiques sont omniprésents dans l’environnement, l’eau et l’alimentation. Leur présence dans le corps humain est désormais un sujet de préoccupation majeur pour la santé publique. Cette étude se concentre sur une question cruciale : l’exposition à ces polluants environnementaux peut-elle interagir avec des facteurs de risque génétiques pour accélérer le déclin cognitif ? En examinant les effets des microplastiques sur le gène de l’apolipoprotéine E(APOE4), un facteur connu dans la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont mis en évidence un mécanisme potentiel reliant la pollution environnementale à la vulnérabilité cérébrale.
Protocole de l’étude : exposition aux particules de polystyrène
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet synergique d’une exposition aux nanoplastiques et du génotype APOE sur la santé.
- Modèle génétique : Les chercheurs ont utilisé des souris génétiquement modifiées pour exprimer les versions humaines du gène APOE. Deux groupes principaux ont été étudiés : les souris APOE4 (portant le facteur de risque génétique pour l’Alzheimer) et les souris APOE3 (groupe témoin, non associé à un risque accru).
- Exposition : Les souris ont été exposées à des microplastiques et nanoplastiques (particules de polystyrène, PS-NMPs) de deux tailles différentes (0.1 et 2 µm) pendant une courte durée de trois semaines. L’exposition se faisait par ingestion, mimant une contamination environnementale courante.
- Évaluation : Après l’exposition, les chercheurs ont procédé à des évaluations comportementales et cognitives complètes (test de reconnaissance de nouveaux objets pour la mémoire, évaluation de l’activité locomotrice). Des analyses tissulaires ont également été réalisées pour mesurer l’accumulation des particules dans les organes, y compris le cerveau, ainsi que les marqueurs d’inflammation neuronale (astrocytes et microglie) et les altérations métaboliques (enzyme CYP1A1 dans le foie).
Résumé des résultats de l’étude
L’étude a démontré que les microplastiques pénètrent dans de multiples systèmes organiques, y compris le cerveau, et que leurs effets néfastes sur la cognition sont fortement dépendants de la génétique et du sexe.
- Accumulation systémique : Les particules de plastique se sont accumulées dans divers organes, y compris le cerveau, confirmant leur capacité à traverser les barrières biologiques.
- Déficits cognitifs spécifiques : Des altérations significatives de la mémoire et du comportement n’ont été observées que chez les souris porteuses du génotype APOE4, et non chez les souris APOE3 du groupe témoin.
- Les souris mâles APOE4 ont présenté une augmentation de l’activité dans les zones vulnérables du cerveau, reflétant une désinhibition et une apathie, des symptômes observés chez les patients humains atteints d’Alzheimer.
- Les souris femelles APOE4 ont montré des déficits marqués dans la reconnaissance d’objets nouveaux, indiquant une altération de la mémoire à court terme.
- Voies biologiques affectées : L’exposition aux microplastiques a entraîné des modifications spécifiques des marqueurs de l’inflammation cérébrale (astrocytes et microglie) et des enzymes hépatiques impliquées dans le métabolisme des toxines environnementales, suggérant une perturbation des voies immunitaires et métaboliques.
- Interaction gène-environnement : Les résultats suggèrent que les microplastiques et nanoplastiques interagissent avec l’allèle APOE4 pour exacerber la prédisposition génétique au déclin cognitif.
Ce que nous pouvons faire pour notre santé selon cette étude
Bien que menée sur des modèles animaux, cette recherche renforce la nécessité de réduire l’exposition aux microplastiques pour préserver la santé cognitive et la longévité, en particulier chez les individus génétiquement vulnérables.
- Limiter l’exposition aux sources connues : Puisque les plastiques de polystyrène sont courants, il est important de réduire l’utilisation de contenants alimentaires, de boissons ou d’emballages en plastique, surtout ceux qui sont chauffés ou usés. Cela réduit l’ingestion potentielle de micro- et nanoplastiques.
- Filtrer l’eau potable : Étant donné que l’eau est une source majeure de NMPs, l’utilisation de systèmes de filtration qui ciblent les microparticules peut réduire l’apport quotidien.
- Connaître sa vulnérabilité génétique : Bien que les tests APOE4 ne soient pas systématiques, les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies neurodégénératives pourraient envisager une réduction plus stricte de l’exposition aux polluants environnementaux, car la recherche indique une sensibilité accrue.
- Soutenir le nettoyage hépatique : L’altération des enzymes hépatiques (CYP1A1) suggère que les microplastiques interfèrent avec la capacité du corps à métaboliser les toxines. Maintenir une bonne santé hépatique par une alimentation riche en antioxydants et des habitudes de vie saines pourrait soutenir les défenses naturelles contre ces polluants.
Conclusion
Cette étude établit un lien troublant entre une exposition de courte durée à la pollution plastique et une altération rapide des fonctions cognitives, particulièrement chez les individus génétiquement prédisposés (génotype APOE4). Elle positionne les microplastiques non seulement comme des polluants environnementaux, mais aussi comme des facteurs potentiels de neurodégénérescence qui interagissent avec notre génétique. La protection de la santé cérébrale à long terme dépend de plus en plus de la réduction de notre exposition à ces toxines omniprésentes.
Source
Gaspar, L., Bartman, S., Tobias-Wallingford, H., Coppotelli, G., & Ross, J. M. (2025). Short-term exposure to polystyrene microplastics alters cognition, immune, and metabolic markers in an apolipoprotein E (APOE) genotype and sex-dependent manner. Environmental Research Communications, 7(8), 085012. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/adf8ae